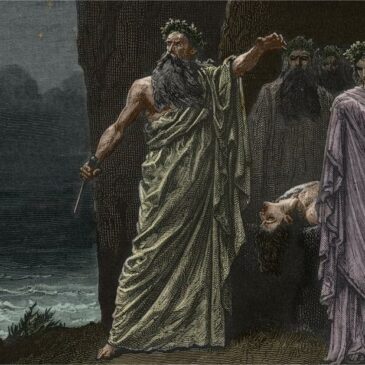Le nationalisme du XIXème siècle et la tendance dite « traditionaliste » ont poussé un certain nombre d’auteurs catholiques français de cette époque à donner une image excessivement positive des Gaulois, de leurs druides et de leurs doctrines religieuses, en présentant les druides comme de sages précurseurs du christianisme. Si l’on peut reconnaître que la civilisation gauloise avait un certain degré d’élévation au point de vue naturel, il est bon de ne pas oublier ce qu’a été l’horreur de la religion gauloise, et le niveau d’abaissement moral dans lequel le paganisme a jeté nos ancêtres, avant la prédication de l’Evangile.
Les druides et leur doctrine
Les sympathisants des druides ont voulu faire une distinction nette entre ce qui serait, d’une part, le noble « druidisme », doctrine spirituelle élevée, et d’autre part le paganisme populaire, fait de rites superstitieux et grossiers. C’est la même distinction que certains auteurs insistent à faire entre le brahmanisme, la doctrine initiatique des savants indiens, et le paganisme hindou grossier et immoral.
S’il est vrai que dans les deux cas, une caste de savants et de sages a pu atteindre par la réflexion, ou par des souvenirs de la révélation primitive, certaines vérités de l’ordre naturel, il est impossible de démontrer qu’il y a eu dans la pratique une opposition nette entre les deux, et les textes indiquent plutôt que les druides ou les brahmanes restaient, quoi qu’on en dise, les chefs et les gardiens de cette religion superstitieuse et grossière à laquelle certains prétendent qu’ils s’opposaient.
D’après les différentes sources historiques sur les sociétés celtiques de l’antiquité, les druides semblent avoir été en effet les maîtres tout-puissants dans la société, faisant régner une sorte de terreur sacrée même jusque chez les nobles et les rois.
L’auteur grec Dion Chrysostome parle ainsi de leur puissance :
Dans tous ces cas, les rois ne sont pas autorisés à faire ou à envisager quoi que ce soit sans l’aide de ces hommes sages, au point que, en vérité, c’était eux qui gouvernaient, alors que les rois étaient leurs serviteurs et ministres de leurs volontés.
Discours, 49, 8.
Des sources irlandaises du VIIIe siècle déclarent qu’en Irlande, avant Saint Patrick et jusqu’à sa venue sur l’île, les druides avaient, comme dans l’ancienne Gaule, un statut d’autorité religieuse et juridique suprême : ils étaient tout à la fois juges, savants, guérisseurs, magiciens, sacrificateurs. Ces légendes irlandaises semblent indiquer que les druides avaient, fondamentalement, une dignité supérieure aux rois. Jules César atteste pareillement que les druides, très organisés et même dotés d’un chef suprême, formaient une sorte d’autorité juridique suprême pour les Gaulois.
Comment peut-on supposer que la religion gauloise populaire leur ait été contraire, qu’elle n’ait pas satisfait à leurs exigences ? Cette supposition ne s’accommode pas avec le statut sacerdotal des druides dans la société gauloise (ils présidaient aux principales cérémonies et aux sacrifices), ni avec leur pouvoir juridique et politique.
Tenter d’excuser les druides de superstition ou de paganisme proprement serait une entreprise vaine, quand on voit que toutes les sources qui se rapportent à eux les présentent comme des magiciens et des devins. La distinction entre les « bons druides » sages et honnêtes, et des mauvais prêtres païens gaulois, est une distinction qu’il est difficile ou impossible de soutenir à partir des documents historiques : selon les sources, le terme druide est appliqué plus ou moins largement à toutes les fonctions sacerdotales du monde gaulois, ou restreint à une fonction plus philosophique et scientifique. Mais même dans le second cas, ils sont prêtres, sacrificateurs et magiciens.
Le seule druide dont l’histoire ait certainement retenu le nom est Diviciacos, l’ambassadeur des Éduens (un peuple gaulois) auprès du Sénat romain vers l’an 60 av. J.-C. Sa vie et son attitude semblent loin de l’image simplifiée du sage retiré dans les forêts dans une vie quasi-monastique, contemplant les lois de la nature : c’est un homme en armes (il est resté célèbre pour avoir plaidé face au Sénat appuyé sur son bouclier), qui participe activement aux guerres des Gaules et à la politique de sa cité, qui est très riche, marié et père de famille. Il parle probablement le grec. Cicéron, qui semble l’avoir rencontré personnellement lors de son passage à Rome, dit qu’il est très versé dans « l’art » éminemment superstitieux de la divination.[1] En somme, un druide ne semble pas très différent d’un prêtre romain païen, qui cumule cette dignité avec d’autres dignités mondaines (Jules César était prêtre, et même « grand-prêtre », pontifex maximus), bien que les Gaulois n’admettent pas, en principe, le cumul des magistratures et du sacerdoce.
Comme les brahmanes (adeptes du brahmanisme), les druides enseignent la doctrine de la métempsychose ou réincarnation de l’âme. Si certains s’étonnent avec admiration qu’un peuple païen puisse professer l’immortalité de l’âme, il convient de ne pas oublier ce que signifie la réincarnation en pratique, et quelle genre de « spiritualité » elle encourage : le principe païen fondamental est que seule compte la jouissance des biens de la terre, et la « réincarnation » est une promesse de retrouver cette jouissance sensible après la mort dans une autre vie, ou de l’atteindre plus parfaitement dans une autre vie. C’est pourquoi la réincarnation est une doctrine aussi populaire dans le monde occidental actuel, qui ne comprend plus la valeur des choses spirituelles, et encore moins des choses surnaturelles.
Les druides n’étaient pas simplement des sages ou des contemplatifs, ils étaient avant tout des prêtres, c’est-à-dire des sacrificateurs. Diodore de Sicile atteste qu’aucun sacrifice ne prend place sans l’assistance des druides :
La coutume est chez eux que personne ne sacrifie sans l’assistance d’un philosophe [un druide]; car ils croient devoir user de l’intermédiaire de ces hommes qui connaissent la nature des dieux, et parlent on pourrait dire leur langue, pour leur offrir des sacrifices d’action de grâces et implorer leurs bienfaits. »
Bibliothèque historique, V, 31.
Il est un genre de sacrifice particulier dans la société gauloise auquel les druides ne pouvaient pas ne pas prendre part : le sacrifice humain.
Les sacrifices humains
Tout le peuple gaulois est très religieux ; aussi voit-on ceux qui sont atteints de maladies graves, ceux qui risquent leur vie dans les combats ou autrement, immoler ou faire vœu d’immoler des victimes humaines, et se servir pour ces sacrifices du ministère des druides ; ils pensent, en effet, qu’on ne saurait apaiser les dieux immortels qu’en rachetant la vie d’un homme par la vie d’un autre homme, et il y a des sacrifices de ce genre qui sont d’institution publique. Certaines peuplades ont des mannequins de proportions colossales, faits d’osier tressé, qu’on remplit d’hommes vivants : on y met le feu, et les hommes sont la proie des flammes. Le supplice de ceux qui ont été arrêtés en flagrant délit de vol ou de brigandage ou à la suite de quelque crime passe pour plaire davantage aux dieux ; mais lorsqu’on n’a pas assez de victimes de ce genre, on va jusqu’à sacrifier des innocents.
Jules César, Guerre des Gaules, 16.
Certains historiens modernes ont nié ou minimisé cette pratique du sacrifice humain dans la société gauloise, et dans les sociétés païennes d’une manière générale. C’est peut-être parce que ce fait est gênant par rapport au mythe d’un monde païen « ouvert » et « tolérant », par opposition au monde chrétien, qu’on accuse d’avoir détruit l’heureuse « diversité » du monde antique.
Ainsi on peut voire certains dire, sans avancer de preuve ferme, que Jules César comme d’autres Romains invente ou exagère ces faits pour diffamer les Gaulois, pour justifier sa conquête, pour les montrer plus féroces et plus barbares qu’ils ne l’étaient. Cette hypothèse de la diffamation n’est, à notre avis, étayée par rien de sérieux. D’autres témoignages historiques et archéologiques nous informent de la réalité du sacrifice humain comme une institution fondamentale de la société gauloise, et de la participation active des druides dans ces sacrifices.
D’autres historiens ont avancé que Jules César décrivait les mœurs des gaulois en ayant recours à des sources archaïques, et que de son vivant les sacrifices humains n’étaient plus pratiqués. A considérer que cela soit vrai, on doit toujours constater que l’institution druidique a été concernée par ces pratiques, à un moment ou à un autre de l’histoire gauloise.
1- Les sources grecques et romaines
Le géographe grec Strabon parle en ces termes du sacrifice humain pratiqué par les druides :
Les Romains réussirent pourtant à les faire renoncer à … maintes pratiques de leurs sacrificateurs et de leurs devins qui répugnaient trop à nos mœurs : il était d’usage, par exemple, que le malheureux désigné comme victime reçût un coup de sabre [à l’endroit des fausses côtes,] puis l’on prédisait l’avenir d’après la nature de ses convulsions [et cela en présence des Druides], vu que jamais ils n’offraient de sacrifices sans que des Druides y assistassent. On cite encore chez eux d’autres formes de sacrifices humains : tantôt, par exemple, la victime était tuée [lentement] à coups de flèches, tantôt ils la crucifiaient dans leurs temples, ou bien ils construisaient un mannequin colossal avec du bois et du foin, y faisaient entrer des bestiaux et des animaux de toute sorte pêle-mêle avec des hommes, puis y mettant le feu, consommaient l’holocauste.
Géographie, IV, 4, 5.
Le célèbre historien Diodore de Sicile évoque l’association entre sacrifice humain et pratiques divinatoires :
Après avoir consacré un homme, ils [les devins] le frappent avec une épée de combat dans la région au-dessus du diaphragme, et quand la victime est tombée sous le coup, ils devinent l’avenir d’après la manière dont elle est tombée, l’agitation des membres et l’écoulement du sang. C’est un genre d’observation ancien, longtemps pratiqué et en qui ils ont foi.
Bibliothèque historique, V, 31.
Dans les années qui suivent la conquête romaine, les empereurs romains prennent des mesures légales contre le druidisme, sans doute parce que les druides prennent une part active aux révoltes contre l’autorité romaine, mais aussi, au moins en partie, parce que les druides pratiquent des sacrifices humains.
Suétone, dans sa Vie des Douze Césars, explique que l’empereur Claude « abolit entièrement dans les Gaules la religion cruelle et barbare des Druides, qu’Auguste n’avait interdite qu’aux citoyens. » (Claude, 25). Auguste avait en effet défendu aux citoyens romains de revêtir la fonction de druide, sachant que la majorité des Gaulois n’étaient pas encore citoyens.
Pline l’Ancien dit que c’est Tibère qui a aboli le druidisme :
Les Gaules ont été aussi possédées par la magie, et même jusqu’à notre temps; car c’est l’empereur Tibère qui a supprimé leurs druides, et ce genre de prophètes et de médecins.
Histoire naturelle, Tome II, Livre XXX.
L’historien Fustel de Coulanges note que cette « interdiction du druidisme » est restreinte aux pratiques les plus extrêmes de magie et de sacrifice humain, et qu’elle n’inclut pas l’ensemble de la religion gauloise.[2] Reste donc une association assez nette, dans la plupart des sources contemporaines, entre druidisme et sacrifice humain.
2- Les sources archéologiques
Si l’on voulait croire que tous les documents d’origine grecque et romaine sont trop biaisés et ne constituent pas une source fiable sur les pratiques des druides, force est de constater que d’autres sources archéologiques, mythologiques et historiques inclinent vers la véracité de leurs récits.
Le sanctuaire celtique de Gournay-sur-Aronde (dans l’Oise), datant du IIIe siècle av. J.-C, est rempli d’une multitude de restes humains, qui sont généralement interprétés comme des « trophées » prélevés sur le corps de guerriers morts. Il n’est pas exclu, pourtant, que tout ou partie des victimes aient été tuées sur place dans un but sacrificiel, le lieu ayant certainement en soi une vocation sacrificielle, comme en attestent les ossements animaux du site. Le sanctuaire de Ribemont, dans la même région et à la même époque, contient un nombre spectaculaire d’ossements humains, avec une même ambiguïté concernant le fait qu’ils aient pu être tués dans des actes de guerre ou dans des actes sacrificiels. Le sanctuaire de Roquepertuse (dans les Bouches-du-Rhône) est rempli de crânes humains, qui étaient incrustés dans des portiques. Le site archéologique d’Acy-Romance (dans les Ardennes) présente des ossements de personnes tuées sur place et inhumées rituellement dans le cadre d’un « sacrifice chtonien » : le cadavre est déposé dans le sol pour que les divinités sous-terraines s’en nourrissent. Il est à noter que l’inhumation n’est pas le rituel funéraire ordinaire chez les Gaulois (c’est plutôt la crémation), ce qui renforce l’idée du caractère sacrificiel de ces lieux.
Voilà ce que l’archéologie nous apprend sur les sanctuaires druidiques. Ils sont remplis de crânes et d’ossements de personnes tuées violemment, dont le cadavre a fait l’objet d’une préparation rituelle.
D’autres sources historiques attestent que les sacrifices humains étaient pratiqués dans les sociétés apparentées aux Gaulois, qui partagent la même religion druidique : les Celtes de Grande-Bretagne et d’Irlande. D’après les récits sur la vie de Saint Patrick, une divinité irlandaise en particulier (Crom Cruach) était apaisée par les sacrifices humains. Ces mêmes récits parlent d’ailleurs de la lutte du grand saint contre les druides, qui n’ont donc visiblement pas accueilli l’Evangile comme étant en « continuité » avec leur doctrine.
Autres manifestations de barbarie chez les Gaulois
Le sacrifice humain proprement dit n’est pas le seul fait de la société gauloise qui atteste de leur cruauté et de leur peu de respect pour la vie humaine.
Les peuples Celtes, Gaulois y compris, avaient développé une obsession étrange pour les têtes d’ennemis vaincus :
Au sortir du combat, ils suspendent au cou de leurs chevaux les têtes des ennemis qu’ils ont tués et les rapportent avec eux pour les clouer, comme autant de trophées, aux portes de leurs maisons.
Strabon, Géographie, IV, Chapitre V.
Les récits de la mythologie irlandaise semblent attester que des pratiques similaires de décapitation des ennemis existaient chez les anciens Irlandais. Plusieurs des sites archéologiques que nous avons cités figurent des crânes humains exposés comme des trophées.
D’autres documents attestent que des pratiques suicidaires plus ou moins ritualisées sont courantes chez les Gaulois. Pomponius Mella, pourtant très élogieux envers les Gaulois, note comme Jules César qu’il est de coutume chez eux de voir des gens s’immoler sur le bûcher d’un mort dont ils étaient proches :
De là [de la croyance en la survivance de l’âme] vient que les Gaulois brûlent et enterrent avec les morts tout ce qui est à l’usage des vivants, et qu’autrefois ils ajournaient jusque dans l’autre monde l’exécution des contrats ou le remboursement des prêts. Il y en avait même qui se précipitaient gaiement sur les bûchers de leurs parents, comme pour continuer de vivre avec eux.
Jules César dit plus sobrement :
On brûlait avec le mort les esclaves et les clients qu’on lui savait avoir été chers.
C’est encore une ressemblance peu flatteuse avec la religion et les mœurs de l’Inde.
Conclusion
En vain on cherchera une source contemporaine des Gaulois qui nie la réalité ou l’importance du sacrifice humain, et d’autres pratiques barbares, dans la société gauloise. « L’esprit critique » des auteurs modernes sur le sujet, qui appellent à ne pas être dupe des biais des Romains ou des Grecs, relève plus de l’imagination et de la spéculation que de la critique : leur mépris par principe des Barbares aurait poussé ces Romains et ces Grecs à inventer de toute pièce ces faits extraordinaires, ou à exagérer la gravité de pratiques religieuses qu’ils ne comprennent pas. Mais ces mêmes auteurs qui parlent de sacrifices humains, y compris Jules César, sont par ailleurs élogieux et admiratifs de certains aspects du monde celto-gaulois, n’hésitant pas à comparer les druides aux savants pythagoriciens, reconnaissant l’étendue de leurs connaissances sur les forces de la nature. On ne trouve pas chez eux une sorte de biais anti-gaulois aveugle. Par ailleurs, le sacrifice humain existe aussi dans le monde romain, même si ce n’est que de manière plus rare à cette époque (il a été rendu illégal à Rome en 97 av. J.-C.). Trop de savants modernes semblent intellectuellement incapables de faire face à la brutalité et à l’inhumanité du monde préchrétien, et cherchent à l’atténuer ou à la recouvrir de toutes sortes de précautions, en parlant par exemple de sacrifices humains « seulement occasionnels » ou « peu violents » (!).
Il serait regrettable que des catholiques reprennent à leur compte ces atténuations ou ces distinctions concernant la religion des gaulois, qui ne sont étayées par aucune source et aucun fait positif. L’idée que le druidisme ait été précurseur du christianisme est vraiment hasardeuse, si l’on prend la peine d’étudier les sources historiques disponibles à ce sujet. On ne peut pas opposer simplement un fait, qui est en fait une simple hypothèse – la présence de prophéties annonçant la Sainte Vierge et le Sauveur dans le fond des doctrines druidiques – à une multitude de faits beaucoup plus avérés qui ne vont pas dans ce sens.
L’amour de la patrie et des ancêtres n’exige pas de transformer l’histoire en mythes selon notre convenance. Les auteurs catholiques du XIXe siècle, pour admirables qu’ils soient sur d’autres sujets, ont leurs défauts et leurs lacunes en matière d’histoire nationale : souvent simplistes, préférant ce qui semble le plus glorieux pour la patrie à ce qui est le plus vraisemblable, ou même à ce qui est le plus avéré, d’un point de vue historique. Pour notre part, nous souhaitons nous en tenir à ce qui apparaît comme la vérité historique, c’est-à-dire que la société gauloise et les druides qui la dirigeaient étaient imprégnés d’une cruauté et d’une dépravation qui dépasse l’entendement. Il faudrait aller au fin fond des forêts de l’Amazonie, de l’Afrique ou de l’Asie du Sud, dans des sociétés qui n’ont connu quasiment aucune influence de l’Evangile, pour retrouver un niveau similaire de barbarie.
Est-il étonnant de découvrir l’horreur de la religion druidique par cette étude des sources historiques ? Ne savions-nous pas déjà qu’elle était dépravée, par le simple fait qu’elle est idolâtre ? Que dit la Bible de l’idolâtrie et de ses prêtres ? Et entre les païens, force est de constater que le paganisme celtique revêtait un caractère de barbarie supplémentaire par comparaison à un paganisme qu’avait tempéré, chez les Romains et les Grecs, les influences civilisatrices de la philosophie. Où voit-on, concrètement, l’influence civilisatrice de la doctrine des druides ? S’ils étaient bien les maîtres de la société gauloise, comme semblent le dire les sources historiques, comment expliquer que cette société soit restée dans un tel état de barbarie, si leur doctrine était si bienfaisante ? Les Romains, en venant sur notre sol et en abolissant le druidisme, n’ont fait que tempérer ce fond de barbarie, et seul l’Evangile, prêché par les saints missionnaires et implanté au fil des siècles par le travail constant de l’Eglise, nous en a vraiment libérés.
Jean-Tristan B.
[1] « Même dans les nations barbares on ne néglige pas la science divinatoire. Ainsi dans la Gaule elle a pour représentants les druides, dont l’un l’Éduen Divitiacus, ton admirateur, lié à toi par les liens de l’hospitalité, m’est connu; il assurait qu’il était versé dans la science de la nature, ce que les Grecs appellent phusiologia, et il prédisait aussi l’avenir tantôt par le moyen des augures, tantôt par l’interprétation des signes » (Cicéron, De divinatione, XLI).
[2] « En résumé, Rome a interdit certaines pratiques de magie, elle a défendu absolument les sacrifices humains, elle a renversé ou a laissé tomber l’organisation druidique ; voilà tout ce qu’on peut affirmer qu’elle ait fait disparaître. Quant à une persécution contre les croyances, à l’abolition du culte, à des rigueurs contre les prêtres, il n’y en a pas le moindre indice dans les documents. » (https://www.mediterranee-antique.fr/Auteurs/Fichiers/DEF/Fustel%20de%20Coulanges/Druidisme/Druidisme.htm)
ℹ Toute reproduction de nos contenus est possible à condition de citer notre site et de mettre un lien vers celui-ci.
Related Posts
None found