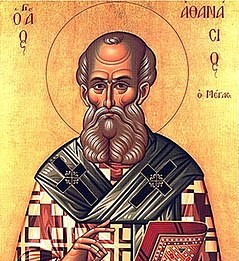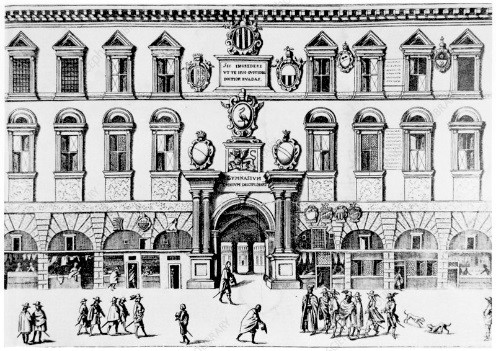Raisons patristiques : les Pères affirment la papauté
3- Les Pères affirment négativement la papauté, en ne protestant pas contre les prétentions de Rome
Avant d’étudier les témoignages positifs des Pères en faveur de la papauté, il nous faut nous arrêter sur un point qui est rarement évoqué, et qui a pourtant toute son importance dans le débat entre catholiques et schismatiques : où sont les témoignages des pères contre la papauté ?
La réponse est très simple, il n’y a jamais eu de protestation des Pères à l’égard des titres et des prétentions de l’Eglise de Rome, qui – contrairement à la légende moderne colportée par les universitaires de gauche et par les ennemis de l’Eglise en tout genre – ne sont pas soudainement apparus au milieu du Moyen-Age, sous l’impulsion des moines de Cluny et de la réforme grégorienne, alors que l’ensemble des chrétiens auraient auparavant vécu sous le régime de la “pentarchie”, où les 5 patriarches les plus éminents de la chrétienté (Rome, Constantinople, Jérusalem, Antioche, Alexandrie) auraient dirigé l’Eglise sur une sorte de pied d’égalité. Cette conception de la pentarchie relève largement du mythe, car il a bien toujours existé une primauté de juridiction et de magistère de l’évêque de Rome (spécialement visible dans le fait que les évêques d’Orient y compris ceux de Constantinople, d’Antioche et d’Alexandrie recourent sans cesse à Rome 1) pour trancher les conflits et surmonter leurs difficultés internes, et 2) pour condamner les hérésies), qui n’est pas une simple primauté honorifique due au statut politique de Rome, mais une primauté due aux pouvoirs que le Christ a donné à Saint Pierre.
Les schismatiques répondront peut-être qu’il n’y a pas eu de protestation contre la papauté car à cette époque les évêques de Rome n’avaient pas été gagnés par la “folie des grandeurs” de la réforme grégorienne, par les “idées extrémistes” du moine Hildebrand, devenu pape sous le nom de Grégoire VII. Si “folie des grandeurs” il y a, force est de constater qu’elle a commencé bien avant Cluny et qu’on en trouve des traces non équivoques dès l’antiquité, tout au long du Haut Moyen-Age, et pas uniquement en Occident. En vérité, ce que l’on constate dans l’histoire ancienne de l’Eglise est que les véritables orthodoxes ne contestent jamais les prérogatives de Rome, tandis que seuls les esprits teintés de schisme et d’hérésie se plaignent d’un “abus de pouvoir” ou d’une mauvaise interprétation des évangiles en faveur de la primauté pontificale.
L’étude de Mgr Batiffol sur les titres de l’évêque de Rome dans l’antiquité et le début du Moyen-Age (Cathedra Petri, 1938) nous fournit de nombreux et éclairants exemples sur cette primauté romaine revendiquée et manifestée dès l’antiquité, et jamais contestée par les véritables orthodoxes. Une autre étude de ce type, plus élargie, a été réalisée en 2003 par Scott Butler et John Collorafi (Keys over the Christian world: Evidence for Papal Authority [33 A.D.- 800 A.D.] from Ancient Latin, Greek, Chaldean, Syriac, Armenian, Coptic and Ethiopian documents). Nous en recommandons la lecture à ceux qui souhaitent approfondir le sujet.
Pour cet article nous ne sélectionnons que quelques exemples d’histoire ancienne de l’Église, dont certains datent d’avant que l’Église ait développé le moindre lien avec les autorités de l’empire romain, dans lesquels il est évident que Rome a revendiqué une primauté, non seulement en paroles mais en actes, et que cette primauté n’a pas fait l’objet d’une contestation forte et durable, l’ensemble des chrétiens la considérant comme normale même si certains ont contesté parfois la manière ou le sujet sur lesquels elle s’appliquait. Le principe de la primauté romaine était, implicitement ou explicitement, accepté par les chrétiens les plus sérieux, y compris en Orient.
Il est absurde de prétendre que ce principe est lié au prestige politique de la ville, dans un contexte où cette ville, mondialement réputée pour ses mœurs débauchées, est le siège d’un empire païen persécuteur, et aussi – ce qui ne manque pas d’importance – dans un contexte où la chrétienté romaine est beaucoup plus culturellement influencée par l’Orient que l’inverse (la liturgie même de l’église de Rome est en grec jusqu’au IVème siècle, et beaucoup de papes sont d’origine orientale). Rome, d’une manière générale, est d’un prestige culturel inférieur à l’Orient et les Romains de la haute société parlent grec en signe de distinction. Il n’y a aucune “primauté honorifique” crédible qui puisse être attachée à Rome par opposition aux autres sièges apostoliques avant que l’empire romain ne devienne chrétien. Seule la transmission du pouvoir de la primauté de Saint Pierre aux évêques de Rome peut expliquer ce qui s’est passé dans les épisodes d’histoire (très) ancienne de l’Église ci-dessous.
1- La controverse sur la date de Pâques (c. 190)
Alors que l’Eglise vivait encore dans les catacombes, les contacts humains et épistolaires entre les différentes Églises et spécialement entre Rome et les Églises d’Orient étaient permanents. L’Occident et l’Orient ont en ce temps-là un mode de calcul différent pour la date de Pâques, l’Orient suivant l’ancienne coutume juive. Ce sujet inquiétait les papes du IIème siècle qui craignaient de voir une différence aussi importante entre l’Orient et l’Occident dans la loi de prière.
Le pape Victor Ier (189-199) s’empare de ce sujet d’une manière violente et excommunie les évêques d’Asie mineure : comment interpréter une telle action ? Il est impossible que l’évêque de Rome ait pris cette initiative si extrême, s’il n’estimait pas (et si l’ensemble des chrétiens n’estimaient pas) qu’elle était fondée en droit. Cette décision, sans doute excessive, fut contestée par les intéressés : mais il est fort intéressant d’étudier dans quels termes prennent place la contestation. Eusèbe de Césarée, dans le Vème tome de son Histoire ecclésiastique, explique que les Asiates ont contesté la violence de l’action, mais pas les pouvoirs de l’évêque de Rome : on ne voit aucun de ces anciens pères, bien qu’ils expriment un fort désaccord, contester comme le fit Photius que l’évêque de Rome ait même le droit d’excommunier un autre évêque en dehors de sa juridiction territoriale spécifique. Voyez le passage d’Eusèbe :
Sur ce, le chef de l’église de Rome, Victor, entreprend de retrancher en masse de l’unité commune les chrétientés de toute l’Asie ainsi que les églises voisines, les tenant pour hétérodoxes. Il notifie par lettres et déclare que tous les frères de ces pays-là sans exception étaient excommuniés. Mais cela ne plut pas à tous les évêques, ils l’exhortèrent au contraire à avoir souci de la paix, de l’union avec le prochain et de la charité : on a encore leurs paroles ; ils s’adressaient à Victor d’une façon fort tranchante. Parmi eux encore se trouve Irénée, il écrivit au nom des frères qu’il gouvernait en Gaule. Il établit d’abord qu’il faut célébrer seulement le jour du dimanche le mystère de la Résurrection du Seigneur ; puis, il exhorte Victor respectueusement à ne pas retrancher des églises de Dieu tout entières qui gardent la tradition d’une coutume antique et donne beaucoup d’autres avis
Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, V, 24
Ainsi les évêques concernés, par la voix du grand Saint Irénée, “exhortent respectueusement” le pape de “ne pas retrancher des églises”. Si n’importe quel autre évêque, même un patriarche, avait pris une décision similaire en dehors de sa province ecclésiastique, il aurait été rappelé au fait que ses pouvoirs ne sont pas illimités. Ici pourtant, l’évêque de Rome excommunie les évêques d’Asie, bien loin du “patriarcat occidental” dont aiment parler les schismatiques modernes, et se voit respectueusement demander par Saint Irénée de lever son excommunication, ce qui sous-entend que celle-ci a une forme de validité, autrement il suffirait de l’ignorer. Si les chrétiens d’Orient avaient été animés à l’époque des mêmes sentiments que Photius, le schisme général entre Rome et l’Orient aurait commencé en 190. La manière dont a agi Victor Ier contre les Asiates est sans doute plus choquante que la manière dont a agi le pape Nicolas Ier à l’égard de l’usurpateur Photius. Pourtant, les vénérables Pères de l’Eglise apostolique n’ont pas entrepris à cette occasion de nier que Rome soit “le premier siège”. Suite à cette controverse, l’usage oriental de la célébration de la Pâque s’est peu à peu entièrement aligné sur celui de l’Eglise de Rome.
2- La controverse sur le Baptême des hérétique (c. 250)
Dans la tourmente des persécutions de Dèce (249-250), de nombreux chrétiens ont malheureusement apostasié en acceptant de brûler un grain d’encens aux idoles. Une fois la persécution terminée, nombreux sont ceux qui demandent à être pardonnés et réintégrés dans la communion de l’Eglise. Le statut de ces lapsi divise : certains estiment que l’attitude de l’Eglise, qui consiste à accorder l’absolution aux apostats, est trop laxiste, parmi eux Novatien qui fait schisme et prétend être l’évêque légitime de Rome, et refuse d’accepter à la communion les lapsi pénitents.
A mesure que les persécutions s’éloignent, la secte de Novatien commence rapidement à s’étioler. De nombreux novatianistes veulent revenir dans l’Eglise : la question se pose de savoir s’il est nécessaire de baptiser à nouveau ceux qui ont été baptisés dans la secte novatienne. Saint Cyprien, et avec lui de nombreux évêques africains, défend l’opinion selon laquelle ce second baptême est nécessaire. Le Pape Etienne Ier (254-257) non seulement défend la doctrine contraire (selon laquelle le baptême des hérétiques et des schismatiques est valide, et qu’il est sacrilège d’effectuer un second baptême), mais impose aux autres évêques de rétracter la doctrine du second baptême. S’en suit une lutte passionnée avec le pape qui mène l’Eglise africaine au bord du schisme.
De cet épisode, les schismatiques tentent parfois de puiser des preuves de “l’opposition de Saint Cyprien à la primauté romaine”. La question est en réalité complexe et Saint Cyprien, bien qu’il ait pu agir avec un mauvais esprit, n’a jamais véritablement cherché à réfuter la doctrine de la primauté.
On pourrait tenter par exemple d’utiliser ce passage :
Il ne faut point se retrancher derrière la coutume, mais vaincre par la raison. Pierre, que le Seigneur a choisi tout d’abord, et sur lequel il a bâti son Église, se trouvant par la suite en désaccord avec Paul au sujet de la circoncision, ne montra point d’arrogance ou de prétention insolente ; il ne dit point qu’il avait la primauté, et que les nouveaux-venus et les moins anciens devaient plutôt lui obéir, et il ne méprisa point Paul, sous le prétexte qu’il avait été persécuteur de l’Église, mais il se rendit de bonne grâce à la vérité et aux justes raisons que Paul faisait valoir. Il nous donnait ainsi une leçon d’union et de patience, et nous apprenait à ne point nous attacher avec obstination à notre propre sentiment, mais à faire plutôt nôtres, quand elles sont conformes à la vérité et à la justice, les idées bonnes et salutaires qui peuvent nous être suggérées par nos frères et nos collègues
Saint Cyprien, épître 71
Ce massage montre plutôt :
- Que Saint Cyprien est d’accord pour dire que “le Seigneur a bâti son Eglise sur Pierre”.
- Que le pape de l’époque revendique la primauté.
- Que Saint Cyprien ne dit pas qu’il est faux que Pierre ait la primauté, mais exhorte son successeur à agir avec humilité en acceptant les suggestions qui viennent de l’extérieur si elles sont vraies et justes, au lieu d’imposer toujours son avis au nom de la primauté.
Saint Cyprien reste attaché à ses positions et convoque un concile des évêques d’Afrique, de Numidie et de Maurétanie en septembre 256, pour affirmer plus solennellement la doctrine du second baptême. Le concile s’ouvre sur une déclaration qui semble critiquer l’attitude du pape : “car nul d’entre nous ne se pose en évêque des évêques, nul ne tyrannise ses collègues ni ne les terrorise pour contraindre leur assentiment, vu que tout évêque est libre d’exercer son pouvoir comme il l’entend, et ne peut pas plus être jugé par un autre que juger lui-même un autre”. La critique n’est pas directe mais simplement suggérée, car le contexte de la déclaration est un propos plus général sur le fait que chaque évêque participant à ce concile local est amené à exprimer librement son opinion sans craindre d’être persécuté. Cependant le terme “évêque des évêques” et le vocabulaire de la “tyrannie” et de la contrainte sont probablement un écho du ressentiment de Cyprien contre les revendications du pape.
Saint Cyprien et les évêques africains étaient-ils alors dans une position analogue à celle de Photius, niant la primauté du pape et rejetant ses enseignements ? Ce n’est pas ce que nous apprend l’histoire de cette controverse. Saint Jérôme, écrivant environ un siècle et demi plus tard[1], nous apprend que :
- Saint Cyprien et le concile de Carthage ont envoyé leur décret conciliaire au pape.
- Que le pape (Sixte II, successeur d’Etienne) a refusé leur doctrine.
- Que ces évêques rétractèrent leur opinion suite à la condamnation du Pape, pour accepter la doctrine de la validité du baptême conféré en dehors de l’Eglise.
La controverse s’est donc terminée, après plusieurs remous, par une acceptation de l’enseignement du pape de Rome. Nous avons conservé très peu de traces des interventions de Rome dans cette controverse, en dehors d’une citation du pape Etienne dans une épître de Saint Cyprien ; il est possible qu’à un moment donné, le pape – qui jusque là tentait de convaincre ceux de l’opinion adverse plutôt que de leur imposer une doctrine – a clairement usé de son autorité apostolique pour trancher le débat, et que Saint Cyprien – qui connaissait mieux que quiconque le principe de la primauté, exprimé dans son traité sur l’unité de l’Eglise – a fini par accepter de se rétracter.
3- La controverse arienne et le concile de Sardique (343)
Après la condamnation de l’arianisme par le concile de Nicée (325), un grand nombre d’évêques orientaux se sont malheureusement laissés séduire par des versions « modérées » de l’hérésie arienne et ont activement combattu les défenseurs de l’orthodoxie, dont le plus célèbre fut Saint Athanase, évêque d’Alexandrie entre 328 et 373.
L’empereur Constantin a légalisé le christianisme (313), soutenu l’Eglise et demandé la convocation du Concile de Nicée, mais il est cependant fort novice en théologie et n’est pas lui-même pas véritablement chrétien (il sera baptisé sur son lit de mort par un évêque arien). Pour des raisons non exactement élucidées, peut-être parce qu’il se préoccupe surtout de l’unité extérieure des chrétiens et que l’arianisme modéré est devenu la position majoritaire, il finit par renverser sa politique pour défendre les ariens. Ainsi dans les dernières années de la vie de Constantin (330-337), le parti des ariens devient le plus puissant dans la chrétienté.
Les ariens entreprennent de déposer Saint Athanase lors du concile d’Antioche (335), dirigé par Eusèbe de Nicomédie. A partir de ce moment, l’évêque de Rome entreprend, de sa propre autorité, de briser les décisions illégitimes des évêques d’Orient. Nous voyons le pape prendre fait et cause pour Saint Athanase, et agir véritablement comme s’il était l’autorité suprême dans l’Eglise ; qualité qui ne lui était contestée, en réalité, que par les sympathisants de l’arianisme.
L’historien Socrate de Constantinople (qui écrit son Histoire ecclésiastique vers 440) commente le conciliabule d’Antioche en disant qu’il est illégitime précisément parce que l’évêque de Rome n’était ni présent ni représenté :
Jules Evêque de Rome n’y assista point non plus, et n’y envoya personne en sa place, bien que selon un ancien Canon, il n’était pas permis de rien ordonner dans l’Eglise, sans le consentement de l’Evêque de Rome.
Socrate le Scholastique, Histoire ecclésiastique, Livre II, chapitre 8 dans PG, 67/195
De « l’ancien canon » mentionné par Socrate, nous ne savons rien de précis. Ce commentaire est simplement un témoignage supplémentaire que la primauté du pape était crue par les premiers chrétiens, au point d’être inscrite dans le droit ecclésiastique et ce avant le concile de Sardique dont nous discuterons bientôt. L’historien Sozomène (qui écrit aussi dans les années 440-450) rapporte substantiellement la même chose que Socrate, savoir que le pape a condamné le concile de Tyr et a rappelé qu’il était contraire aux canons de prendre une décision aussi grave pour l’Eglise que la déposition du patriarche d’Alexandrie sans son accord.
En 340, le pape tient un concile à Rome qui annule les décisions du concile de Tyr et rétablit Saint Athanase dans son droit. Pour donner un caractère plus solennel encore aux nouvelles définitions contre l’arianisme, les Occidentaux (surtout Saint Ossius de Cordoue, bras droit du pape ayant joué un rôle important lors du Concile de Nicée), appuyés par les empereurs Constant et Constance, souhaitent réunir un concile œcuménique. La localisation de Sardique (nom antique de Sofia, dans l’actuelle Bulgarie), entre Occident et Orient, est choisie pour permettre au plus grand nombre d’évêques de s’y rendre. La majorité des évêques d’Orient, sympathisants de l’arianisme, n’y participent malheureusement pas, ne supportant pas la présence de Saint Athanase, et multipliant les injures et les attaques contre Rome. C’est un véritable schisme entre l’Occident et la majeure partie de l’Orient qui s’en suit.
Le concile de Sardique rassemble néanmoins, d’après Sozomène, environ 300 évêques d’Occident et 76 d’Orient. D’autres historiens diminuent beaucoup le nombre d’évêques présents, mais cette question a peu d’importance. Les canons de ce concile relative à l’autorité du pontife de Rome (qui n’est par ailleurs même pas présent) témoignent de la foi des chrétiens de l’époque en une autorité suprême du successeur de Saint Pierre, contestée seulement par les sympathisants de l’arianisme :
3. (…) Si cependant un évêque pense qu’il fut condamné pour une affaire, qui à son avis n’est point mauvaise, mais bonne, en sorte que le jugement doive être révisé, s’il plaît à votre charité, honorons la mémoire de l’apôtre Pierre, et que les juges eux- mêmes écrivent à Jules, évêque de Rome, afin que le tribunal, le cas échéant, soit à nouveau constitué par les évêques de la province voisine et que lui-même envoie des arbitres; mais si un pareil tribunal ne peut être constitué -car c’est à lui de décider si l’affaire a besoin d’être révisée -, ce qui fut déjà décidé ne doit pas être remis en question et le décret rendu sera confirmé
Le 3e canon du concile de Sardique déclare que l’évêque de Rome a le pouvoir de réviser en appel la sentence d’un autre évêque, et que c’est « honorer la mémoire de l’apôtre Pierre » que de déclarer ce pouvoir. D’autres canons du même concile entrent dans le détail de ce thème de l’appel à Rome en cas de conflit de juridiction au niveau provincial.
Certains voudraient voir dans ces canons, et pourquoi pas dans la personne d’Ossius, l’origine de « l’invention de la papauté », dans le sens qu’un pouvoir de ce type n’existait pas auparavant et qu’il aurait été arbitrairement attribué à l’évêque de Rome par le concile de Sardique. Ces menteurs sont réfutés par le récit de Sozomène et de Socrate le Scolastique, qui témoignent que c’est en vertu d’un « ancien canon » que l’évêque de Rome proteste contre l’illégitimité du concile oriental réuni contre Athanase plusieurs années avant le concile de Sardique, et que ce pape Jules revendique à ce moment un droit de contrôle sur ces décisions qui pourtant ne relèvent pas de sa province ecclésiastique ou de son « patriarcat occidental ». Nous avons vu, dans les exemples précédents, que cette revendication du pape à réguler les affaires de l’Eglise universelle s’est déjà manifestée aux IIe et IIIe siècles. Le concile de Sardique ne fait donc que confirmer des notions déjà existantes dans la mentalité chrétienne et dans le droit canon.
Nous voyons dans cette affaire que Saint Athanase et tous les orthodoxes acquiescent, tacitement par leur silence, ou explicitement par leur ratification, au pouvoir suprême de l’évêque de Rome dans l’Eglise, un pouvoir tel que celui-ci peut briser en appel n’importe quelle sentence prononcée à un niveau inférieur de la hiérarchie ecclésiastique.
4- L’affirmation de la papauté par le concile de Rome (382)
Peu de temps après le Ier concile de Constantinople (381), l’empereur Théodose Ier réunit un autre synode à Constantinople, auquel le pape ne participe pas : Damase Ier réunit plutôt un concile à Rome, qui est surtout célèbre pour avoir été l’occasion de la définition du canon des Saintes Ecritures. Le concile déclare en outre :
La sainte Église romaine n’a pas été placée en avant des autres par quelque décision synodale mais a obtenu le premier rang par la voix évangélique de notre Seigneur et Sauveur, puisqu’il dit : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l’enfer ne prévaudront pas sur elles, et je te donnerai les clefs du Royaume des cieux et tout ce que tu auras lié sur terre sera lié aussi dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur terre sera aussi délié dans les cieux » (Matthieu 16, 18). La société du très bienheureux Paul, le vase d’élection, lui a été ajoutée, lui qui, combattant, n’a pas été couronné à un (moment) différent, comme les hérésies (le) coassent, mais (l’a été) au même moment, en un seul et même jour, par une mort glorieuse, avec Pierre, dans la ville de Rome, sous le César Néron. Ils consacrèrent également la susdite sainte Église romaine au Seigneur Christ et la placèrent devant toutes villes dans le monde entier par leur puissance (praesentia) et leur triomphe à vénérer. Le premier rang de l’apôtre Pierre revient donc à l’Église romaine, qui n’a ni tache, ni ride, ni rien de ce genre (voir Éphésiens 5, 27). Le deuxième siège a été consacré au nom du bienheureux Pierre par son disciple et évangéliste Marc à Alexandrie, lui qui, envoyé par l’apôtre Pierre, a prêché la parole de vérité et a consommé le glorieux martyre en Égypte. Et c’est du bienheureux Pierre qu’à Antioche on tient l’honorabilité du troisième siège, parce que c’est là-bas qu’il s’était rendu avant d’habiter à Rome et (parce que) c’est là-bas que pour la première fois le nom de chrétiens s’est manifesté (Actes 11, 26) (comme celui d’) une nouvelle nation
Texte tiré du Decretum Gelasianum, 3, éd. E. von Dobschütz, Leipzig, 1912, p. 7 ; “Latin Lists of the Canonical Books. I. The Roman Council under Damasus, A.D. 382”, introd. et éd. C. H. Turner, Journal of Theological Studies, 1, 1899, p. 560.
Il apparaît donc que dès le IVème siècle, les papes énoncent ouvertement la doctrine finalement rejetée par Photius au IXème siècle, et par ses héritiers du XIème siècle, en déclarant que la primauté de Rome provient du premier rang de l’apôtre Pierre, et des paroles prononcées par le Christ sur « les clés du royaume des cieux ».
Conclusion
Ces différents épisodes de l’histoire de l’Eglise nous apprennent :
- Que la prétention à la primauté de la part de Rome existe depuis l’antiquité la plus reculée (exemples des IIème, IIIème et IVème siècles).
- Que cette prétention n’a rien à voir avec la place de la ville dans l’empire romain, mais est explicitement reliée aux paroles de l’évangile sur Saint Pierre.
- Que cette prétention à la primauté n’a pas suscité, parmi les Pères de l’Eglise et plus généralement parmi les orthodoxes, de condamnation ou de réfutation.
- Que les protestations des premiers chrétiens contre les actions de Rome
- Ne portent pas sur le principe même de la primauté.
- Se plaignent de la sévérité de certains papes, mais sans nier leur droit à agir pour réguler les affaires des Eglises à travers le monde.
- Ont tendance à cesser une fois que Rome a exprimé sa volonté de manière suffisamment ferme, et que ceux qui entendent cette volonté sont suffisamment pieux et orthodoxes.
Nous avons donc une affirmation au moins négative de la papauté de la part des Pères qui ne protestent pas contre ces revendications continuelles à la primauté de juridiction et même à l’autorité doctrinale suprême de la part de Rome. Nous verrons, dans la partie suivante, que plusieurs Pères ont plutôt explicitement soutenu ces revendications.
Jean-Tristan B.
[1] Blessed Cyprian… condemning the baptism of heretics, sent [the acts of] an African Council on this matter to Stephen, who was then bishop of the city of Rome, and the twenty-second from Blessed Peter; but his attempt was in vain. Eventually the very same bishops, who had laid down with him that heretics were to be rebaptized, returning to the ancient custom, published a new decree. [Contra Lucif., 23. PL 23: 186]