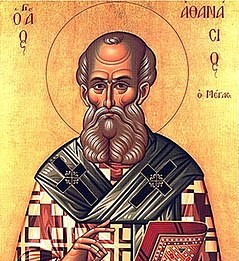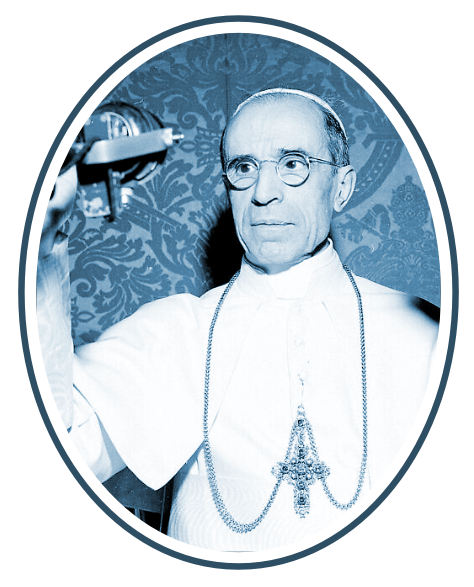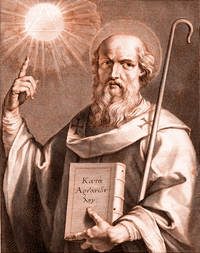- Les sédévacantistes sont schismatiques
- Les sédévacantistes sont hérétiques
- Le constat sédévacantiste est un jugement téméraire et illégitime
- Un pape peut être hérétique
- Il eu des papes hérétiques par le passé
- On a le droit de résister au Pape et à l’Église
- Le Concile Vatican II est pastoral
- Vatican II a été expliqué ensuite
- La vacance du siège est impossible
- Dieu ne peut pas permettre cette situation
- « Les portes de l’enfer ne prévaudront pas »
- Comment concilier la vacance du siège et la succession apostolique ?
- Être sédévacantiste c’est abandonner et sortir de l’Église
Le sédévacantisme est un schisme
Réponse
Un schismatique est quelqu’un qui, méprisant l’enseignement du Christ sur la primauté de Saint Pierre et des pasteurs légitimes de l’Eglise, refuse d’obéir à ses lois et à sa discipline, et érige son propre gouvernement indépendant de celle-ci. Pour dire plus simplement encore, un schismatique est un chrétien qui refuse de se soumettre à l’autorité de l’Eglise, en prétendant que son autorité n’a pas de fondement. Le schisme est un péché mortel contre la charité, car il brise l’unité du Corps Mystique de Jésus-Christ.
Les sédévacantistes ne sont pas des schismatiques car :
- Ils ne nient pas la légitimité des successeurs de Saint Pierre pour légiférer, de manière monarchique et sans contestation possible, sur l’ensemble de l’Église ;
- Ils n’ont nullement l’intention d’ériger une autorité concurrente, une hiérarchie indépendante contre l’autorité et la hiérarchie de l’Église catholique ;
- Ils n’entendent pas, concernant l’administration des sacrements et toute autre chose relative à la religion, agir d’une autre manière que celle qui a été promulguée par l’autorité de l’Église.
Les sédévacantistes s’opposent à ce qui semble être pour beaucoup la hiérarchie de l’Église catholique, non pas par esprit de schisme, mais au contraire par souci de rester fidèle à l’autorité de l’Église catholique qui a enseigné, promulgué et ratifié des doctrines et des dispositions disciplinaires auxquelles s’opposent formellement les nouvelles doctrines (qui sont fausses) et la nouvelle discipline (qui est mauvaise) des conciliaires.
Accuser les sédévacantistes d’être schismatiques serait aussi hors de propos que d’accuser les luthériens de nier que la Bible soit révélée et inerante : le problème du luthéranisme se trouve ailleurs ; ainsi le «problème» du sédévacantiste réside dans la discussion cherchant à savoir si François est Pape ou non, pas sur le fait de savoir s’il faut être soumis au Pape pour sauver son âme – ce dont les sédévacantistes sont absolument convaincus. Or, chercher à savoir si quelqu’un est Pape ou non, c’est simplement faire œuvre de discernement, comme l’ont fait les catholiques et les saints ayant vécu dans des siècles troublés où l’on avait des doutes sur la légitimité de certaines personnes qui prétendaient être Papes ; ce n’est pas faire acte de schisme.
“Finally, one cannot consider as schismatics those who refuse to obey the Roman Pontiff because they would hold his person suspect or, because of widespread rumors, doubtfully elected (as happened after the election of Urban VI), or who would resist him as a civil authority and not as pastor of the Church.” (Wernz-Vidal, Ius Canonicum [Rome: Gregorian 1937], 7:398, my emphasis.)(modifié)[17:21]In fact, Fr. Ignatius Szal emphasizes that one essential ingredient to true and proper schism is that the schismatic, in spite of his disobedience, “must recognize the Roman Pontiff as the true pastor of the Church, and he must profess as an article of faith that obedience is due the Roman Pontiff”
(Rev. Ignatius Szal, The Communication of Catholics with Schismatics [Washington, DC: The Catholic University of America Press, 1948, p. 2).
Les sédévacantistes sont hérétiques
Réponse
Une hérésie est une doctrine qui s’oppose directement à une ou plusieurs vérités révélées contenues dans l’enseignement de l’Église. Un hérétique, au sens formel du terme, est quelqu’un qui adhère à cette doctrine en pleine connaissance de cause, c’est à dire en sachant qu’elle s’oppose à l’enseignement de l’Église catholique. On peut adhérer à des hérésies par ignorance de l’enseignement de l’Église, par suite d’un raisonnement erroné, ou bien par une mauvaise compréhension des dogmes ; cela ne suffit pas à ce que cette adhésion intellectuelle devienne un véritable péché d’hérésie, et fasse mériter devant Dieu et devant les hommes le nom d’hérétique : il faut pour cela ce que l’on appelle la pertinacité, qui est la persévérance dans l’erreur malgré les admonitions de l’Église, malgré la claire connaissance de la réprobation de ses opinions par l’Église. Par commodité on peut dire que ceux qui adhèrent à des hérésies sans faute sont «matériellement hérétiques», et ceux qui y adhèrent avec pertinacité sont «formellement hérétiques». Voir l’article «Hérésie» de la Catholic Encyclopedia
Le sédévacantisme n’est pas une hérésie, et ceux qui adhèrent au sédévacantisme ne sont hérétiques ni matériellement, ni formellement, car :
- Ils ne nient aucun des enseignements de l’Église catholique, que celui-ci soit solennel ou simplement ordinaire, concernant la Papauté, ses prérogatives et ses droits ;
- L’Église n’enseigne pas qu’il est impossible que le siège soit vacant pendant une très longue période : s’il peut être vacant 1 jour, 1 mois ou 1 an, à prendre la chose en soi rien n’interdit qu’il soit vacant 1000 ans, aussi terrible que cela puisse être pour la vie de l’Église et le salut des âmes ;
- L’Église n’enseigne pas qu’il est impossible qu’une personne qui soit élue à la Papauté, et même acceptée pacifiquement comme Pape par l’Église universelle, ne soit pas réellement Pape. Son histoire nous apprend plutôt le contraire, à savoir qu’à une époque a été envisagée le cas où un hérétique (formel) serait élu à la Papauté, et reconnu comme Pape à ce titre : la bulle Cum ex apostolatus officio de Paul IV (1559) déclare une telle élection nulle et sans effet. Par ailleurs il n’a jamais été question, dans la théologie catholique, de dire que l’acceptation pacifique par une unanimité morale des catholiques était une condition ou une preuve du fait que la personne considérée comme telle est réellement Pape.
- Pour notre part, et nous pensons que c’est le cas de la plupart des sédévacantistes, nous professons n’avoir aucune intention d’adhérer à des opinions condamnées par l’Église ni de nous opposer en quoi que ce soit à son magistère, et nous serions prêt à rétracter toutes nos idées et nos positions s’il apparaissait que l’Église les condamnait. Le principe que nous appliquons pour savoir comment régler notre jugement et notre vie toute entière, est celui de coller le plus prêt que possible à l’esprit de l’Église, même en ce qui n’est pas obligatoire et infailliblement promulgué, même pour des questions d’ordre pastoral et pratique.
NB. Il se peut que certaines personnes soient sédévacantistes et adhèrent par ailleurs à des hérésies, c’est le cas des frères Dimond et de leur doctrine dite feeneyiste, qui nie l’enseignement de l’Église catholique concernant le Baptême de désir et le Baptême de sang. Ce problème n’a, en soi, aucun rapport avec le sédévacantisme. Ce serait un peu comme prétendre que tous les jésuites sont hérétiques, parce que quelques jésuites isolés ont défendu des doctrines fausses : il ne faut pas tout confondre, si certains membres d’un groupe adhèrent à des hérésies, cela ne rend pas le groupe en lui-même hérétique. L’analogie est imparfaite parce que les sédévacantistes ne constituent pas «un groupe» bien constitué, mais il s’agit simplement d’un ensemble de personnes qui font profession de foi catholique et qui se retrouvent donc à faire le constat d’une vacance du Saint-Siège. Cette position selon laquelle le Siège apostolique est vacant ne relève en rien de l’hérésie.
Le constat sédévacantiste est un jugement téméraire et illégitime
Réponse
« Si quelqu’un dit que Dieu unique et véritable, notre Créateur et Maître, ne peut pas être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine, au moyen des choses qui ont été créées ; qu’il soit anathème »
L’Eglise défend ici la légitimité d’un jugement fondé sur des vérités naturelles. En l’occurrence : l’existence du monde, son harmonie et le principe de causalité. Ces choses étant certaines, la conclusion l’est aussi. Si un raisonnement correct met en œuvre une vérité de foi fondée sur l’autorité de Dieu et une vérité naturelle évidente, la conclusion exprimera un jugement doté d’une certitude absolue, propre à entraîner l’assentiment plein et entier de l’intelligence. Une telle conclusion est dite théologique. Par exemple : « Jésus est un homme (vérité de foi). Or les hommes ont une âme (vérité naturelle). Donc Jésus a une âme (conclusion théologique) ».
Le constat actuel de la vacance du Siège apostolique n’a pas plus de prétention. Il se sert, dans sa démonstration, de données de foi, de faits d’observation immédiate et du principe de non-contradiction. La foi nous assure de l’infaillibilité du magistère ordinaire et universel. Elle nous assure qu’il est impossible qu’un Pape promulgue avec les évêques représentant l’Eglise universelle un texte contredisant un point de doctrine déjà fixé. Or, une telle promulgation s’est produite lors du concile Vatican II : la déclaration Dignitatis Humanae du 7 décembre 1965 contredit explicitement l’enseignement de Pie IX (entre autres) sur la liberté religieuse dans Quanta Cura (lettre encyclique du 8 décembre 1864). Donc les occupants du Siège apostolique qui ont « promulgué » et maintiennent en union avec tous les évêques une telle doctrine ne peuvent pas être Papes.
| Affirmations condamnées par Quanta Cura, 8 décembre 1864 [« contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des saints Pères »] | Affirmations de Dignitatis Humanae, 7 décembre 1965 [« le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même »] |
|
a) la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande |
a’) de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres |
|
b) La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme |
b’) Ce Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse |
|
c) Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée |
c’) Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil |
Ce qu’affirme Vatican II en (a’), (b’), (c’) est condamné par Quanta Cura en (a), (b), (c). Les deux textes se prononcent sur le même sujet : le droit d’exercice public des religions et des cultes, même non catholiques. Les deux textes en appellent à la Révélation et s’expriment, quoi que dans une époque particulière et en raison même de cette époque, d’une façon absolue, comme énonçant un principe de droit naturel.
Cette conclusion sur l’absence actuelle d’Autorité dans l’Eglise, au demeurant triste à poser et troublante pour tous les fidèles, s’impose dans la lumière de la foi, avec une certitude de l’ordre de la foi. Parce que la foi catholique est une, parce qu’elle n’abolit pas la raison et que le principe de non-contradiction est inhérent à son exercice, il est métaphysiquement impossible d’adhérer religieusement à l’enseignement et par conséquent à l’autorité de ces faux pasteurs. Tout fidèle prudent qui vit effectivement de la foi peut et doit conclure à l’absence d’Autorité. L’exercice de la foi catholique rend impossible l’assentiment à l’enseignement de Vatican II.
Un jugement est téméraire et illégitime si il est prononcé précipitamment, sans intention droite et que les fondements sur lesquels il repose sont incertains ou faux. Par exemple : prêter une mauvaise intention à quelqu’un sans raison. Dans une matière si grave que la foi et avec des certitudes d’un degré tel que nous venons de l’exposer, le jugement s’impose absolument et constitue un devoir. Il ne s’agit pas d’un jugement a priori qui serait consécutif à un caprice de notre part, il s’agit de l’impossibilité métaphysique d’adhérer à une règle de foi qui contredit objectivement l’enseignement de l’Eglise. La meilleure volonté du monde ne pourra pas changer la nature des choses, une chose ne peut pas, en même temps et sous le même rapport, être vraie et fausse. Nous pensons que cela suffit pour fonder la légitimité d’un tel jugement. Les fidèles ne peuvent pas, par jugement privé, ne pas accuser ceux qui « promulguent » ces enseignements, comme les fidèles de Constantinople rompirent la communion avec leur évêque Nestorius entre 428 et 431 (date de sa condamnation), car celui-ci enseignait une doctrine ouvertement contraire à la foi catholique.
L’imprudence se situerait au contraire dans la négation de ce jugement absolument certain. En effet, en rejetant cette conclusion, on est objectivement poussé à relativiser ou à nier des vérités de foi : soit en acceptant l’enseignement de Vatican II et ses suites, qui s’oppose en de nombreux points au Magistère de l’Eglise ; soit en le refusant, attribuant ainsi l’erreur au Pape et à l’Eglise, niant de fait la sainteté et l’infaillibilité de celle-ci.
Les catholiques qui font le constat de la vacance du Siège apostolique ne se substituent nullement à l’Eglise et à son autorité. Ce jugement n’est qu’un constat indubitable, il n’a pas force de loi et n’a pas de portée juridique objective pour l’Eglise. La privation d’autorité qui affecte actuellement l’Eglise rend précisément compliqué une telle sentence authentique. En revanche, de ce jugement certain découle le devoir de ne rien dire ni rien faire qui reviendrait pratiquement à reconnaître l’Autorité à l’actuel occupant du Siège ainsi que celui de proclamer, selon les règles de la prudence et conformément aux moyens dont chacun dispose, la vacance actuelle du Siège apostolique.
« Nous ne pouvons pas ne pas parler »
Act. IV, 20
On a le droit de résister au Pape et à l’Église
Réponse
« Quant à déterminer quelles sont les doctrines révélées de Dieu, c’est la mission de l’Église enseignante, à laquelle Dieu a confié la garde et l’interprétation de ses paroles. Dans l’Église, le docteur suprême est le Pontife Romain. (…) [Il faut l’obéissance au Magistère de l’Église et du Pape]. L’obéissance doit être parfaite, parce qu’elle est exigée par la foi elle-même, et elle a cela de commun qu’elle ne peut pas être partielle… C’est ce que St Thomas d’Aquin explique d’une manière admirable dans le passage suivant:“(…) Or, il est manifeste que celui qui adhère à la doctrine de l’Église comme à une règle infaillible donne son assentiment à tout ce que l’Église enseigne; autrement, si, parmi les choses que l’Église enseigne, il admet ce qu’il veut et n’admet pas ce qu’il ne veut pas, il adhère non plus à la doctrine de l’Église comme à une règle infaillible, mais à sa propre volonté… L’unité [de l’Église] ne saurait être sauvegardée que si toute question soulevée en matière de foi est résolue par celui qui est le chef de l’Église entière, de sorte que sa sentence soit fermement acceptée par toute l’Église. C’est pourquoi de l’autorité du Souverain Pontife seul relève une nouvelle édition du Symbole comme toutes les autres choses qui regardent l’Église universelle” … C’est pourquoi le Souverain Pontife doit pouvoir déclarer avec autorité ce que contient la parole divine, quelles doctrines concordent avec elle et quelles doctrines s’en écartent: pour la même raison, il doit pouvoir montrer ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter pour faire son salut; autrement, il ne pourrait être ni l’interprète infaillible de la parole de Dieu, ni le guide sûr de le vie humaine »
Léon XIII
Cette obéissance appartient à la foi catholique selon saint Pie X :
« C’est dans cette obéissance à la suprême autorité de l’Église et du Souverain Pontife, autorité qui nous propose les vérités de la foi, nous impose les lois de l’Église et nous commande tout ce qui est nécessaire à son bon gouvernement, c’est dans cette autorité que se trouve la règle de notre foi »
Saint Pie X, Catéchisme Romain, Petite Histoire de la Religion, éd. Itinéraires, reprint Dominique Martin Morin, 1978, p. 354
Le Concile Vatican II est pastoral
Réponse
Jésus-Christ a fondé son Eglise en la dotant du pouvoir d’enseigner les vérités contenues dans la Révélation pour les proposer à la foi des fidèles. Fondé sur la Sainte Ecriture, cette infaillibilité a toujours été crue et enseignée par l’Eglise et les théologiens (Voir par exemples l’œuvre de Mgr de Ségur, Le dogme de l’infaillibilité,pp.221-432). L’Eglise enseignante, composée du Pape et des évêques, ne peut pas errer dans son enseignement sur la foi et la morale. Lorsqu’un concile, qui n’est autre que l’Eglise enseignante réunie physiquement, enseigne qu’une vérité est contenue dans la Révélation ou nécessaire à sa compréhension, le fidèle est par le fait même tenu d’y adhérer. En tant que tel, le concile Vatican II aurait donc dû être infaillible toutes les fois qu’il proposait un enseignement en matière de foi et de morale, toutes les fois qu’il exposait une « vérité » contenue dans la Révélation ou nécessairement liée à celle-ci. C’est le cas plusieurs documents du concile qui posent problème à cause de leurs enseignements contraires à la doctrine catholique déjà définie : La déclaration Dignitatis humanae sur la liberté religieuse par exemple. Tous les fidèles auraient dû adhérer religieusement, dans la lumière de la foi, au principe de la liberté religieuse. Évidement, ce principe a déjà été infailliblement condamné par Pie IX (entre autres), signe que le concile Vatican II ne peut pas avoir été promulgué par un pape authentique.
Même dans ses dispositions disciplinaires qui peuvent être modifiées ou abrogées par l’autorité légitime du pape, l’Eglise ne fait qu’appliquer des principes de foi et de morale nécessairement vrais et bons. La discipline et la loi peuvent changer, les principes sur lesquels elles reposent ne le peuvent pas. Si elles peuvent être plus ou moins parfaites, plus ou moins opportunes, elles ne peuvent certainement pas conduire les fidèles qui les observent au mal et à la damnation, elles ne peuvent être nocives à la foi, la morale et le salut éternel : c’est l’inerrance ou « infaillibilité négative » (le cardinal Franzelin l’évoque : FRANZELIN, De Traditione, T. XII, Schol. 1. Cité par L. BILLOT, De Ecclesia Christi, T. I, P. II, c. II, q. X pp. 444-5). Soutenir le contraire va à l’encontre de la sainteté de l’Eglise qui est continuellement assistée par Jésus-Christ en donnant des moyens infaillibles de salut aux fidèles. Pie VI a d’ailleurs jugé cette doctrine « fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, offensive des oreilles pies, injurieuse pour l’Église et pour l’Esprit de Dieu par qui elle est conduite, et erronée pour le moins ». Redisons le donc clairement : même dans ses enseignements « pastoraux », l’Eglise ne peut pas se tromper en matière de foi et de morale.
L’article qui suit apporte une réponse plus détaillée : https://religioncatholique.fr/2021/09/02/peut-on-rejeter-vatican-ii-car-il-sagit-dun-concile-pastoral/
Être sédévacantiste c’est abandonner l’Église et en sortir
Réponse
On entend souvent qu’être sédévacantiste est une désertion et qu’il faut rester fidèle à l’Église malgré la crise et agir de l’intérieur.
Être fidèle à l’Église c’est être fidèle à la Foi. Est-ce que l’Église du Christ peut enseigner l’erreur, promulguer des lois mauvaises, et corrompre les âmes au point qu’elle enseigne une nouvelle religion qui n’a plus rien à voir avec le catholicisme et qui pousse à l’indifférentisme le plus absolu ? Non.
Ce n’est donc pas « l’Église » qui est en train de faire cela et dire qu’il faut « rester dans l’Eglise » dans ces circonstances c’est dire que l’Église est cette société corrompue que l’on voit actuellement.
Pour un catholique d’avant Vatican II, ce serait considéré comme un blasphème de dire que l’autorité de l’Église peut faire cela (enseigner l’hérésie et faire une liturgie protestante).
« Rester dans l’Église » c’est rester dans les paroisses corrompues dont on ressortira indifférent au Christ et à son message, et paradoxalement indifférent à son Église, puisque c’est un autre esprit qui anime la paroisse et toutes ses activités.
Beaucoup de « traditionalistes » qui veulent « infiltrer » ou « influencer de l’intérieur » sont devenus plus modernistes qu’ils ne l’étaient en commençant cette démarche. Cela se vérifie y compris pour la FSSPX qui est dans une mentalité de plus en plus libérale.